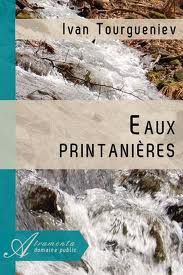
Lorsque Sanine, une heure et demie plus tard, revint à la confiserie Roselli, il fut reçu comme un parent. […]
Devant le sofa, sur une table ronde, recouverte d’une nappe blanche, se dressait une énorme chocolatière de porcelaine, remplie de chocolat odorant, et tout autour des tasses, des verres de sirop, des gâteaux, des petits pains et jusqu’à des fleurs. Six bougies de cire brûlaient dans deux candélabres de vieil argent ; à côté du divan se trouvait un moelleux fauteuil voltaire, et c’est là qu’on invita Sanine à prendre place. […]
Sanine fut obligé de décliner son nom, de dire d’où il venait, de parler de sa famille. Quand il avoua qu’il était Russe, les deux femmes furent un peu étonnées et laissèrent échapper un : « Ah ! » tout en déclarant qu’il parlait très bien l’allemand, mais elles l’invitèrent à continuer la conversation en français si cela lui était plus agréable, car toutes deux comprenaient cette langue et la parlaient.
Sanine s’empressa de profiter de cette aimable proposition.
« Sanine ! Sanine ! » La mère et la fille n’auraient jamais cru qu’un Russe pût porter un nom aussi facile à prononcer. Le petit nom de Sanine, Dmitri, leur plut de même beaucoup.
La mère de Gemma s’empressa de remarquer que dans sa jeunesse elle avait vu un opéra : « Demetrio et Polibio », mais que « Dmitri » sonnait infiniment mieux que « Demetrio ».
Sanine passa aussi une heure en conversation avec les deux Italiennes, qui, de leur côté, l’initièrent à tous les événements de leur vie.
La mère tenait généralement la parole. Sanine apprit d’elle son nom, Leonora Roselli. Elle était veuve de Giovanni Battista Roselli, qui était venu vingt-cinq ans auparavant à Francfort en qualité de confiseur. Giovanni Battista était de Vicenza ; c’était un excellent homme bien qu’un peu emporté et orgueilleux, et par-dessus tout cela, républicain !
En prononçant ces mots, madame Roselli désigna un portrait à l’huile placé au-dessus du divan.
– Il faut croire que le peintre, – « un républicain aussi ! » ajouta madame Roselli en soupirant, – n’avait pas su saisir parfaitement la ressemblance, car sur son portrait, Giovanni Battista apparaissait sous les traits d’un sinistre et féroce brigand, comme un Rinaldo Rinaldini !
Madame Roselli elle-même était née dans la belle et antique cité de Parme, où se trouve cette divine coupole peinte par l’immortel Corrège. Une partie de sa vie pourtant avait été passée en Allemagne, et elle s’était presque germanisée.
Elle ajouta, en branlant tristement la tête, qu’il ne lui restait plus que cette fille et ce fils, et du doigt elle les montrait tour à tour, puis elle dit que sa fille s’appelait Gemma et son fils Emilio, et que tous les deux étaient d’excellents enfants, obéissants, surtout Emilio…
– Et moi, je ne suis pas obéissante ? interrompit Gemma.
– Oh ! toi aussi tu es républicaine ! répondit la mère.
Madame Roselli déclara pour conclure qu’assurément elle gagnait de quoi vivre, mais que les affaires allaient beaucoup moins bien que du temps de son mari, qui était un grand artiste en fait de confiserie.
– Un grand’uomo ! affirma Pantaleone d’un air grave.
Gemma, tout en écoutant sa mère, tantôt riait, soupirait, caressait l’épaule de la vieille dame, la menaçait du doigt, puis la regardait. Enfin, elle se leva, prit sa mère dans ses bras et la baisa sur la nuque à la naissance des cheveux, ce qui fit rire beaucoup la bonne dame tout en poussant de petits cris effarouchés.
Pantaleone, à son tour, fut présenté au jeune Russe.
Pantaleone avait été autrefois un baryton d’opéra, mais il avait depuis longtemps terminé sa carrière artistique et occupait dans la famille Roselli une place intermédiaire qui tenait de l’ami de la maison et du domestique. Bien qu’il fût depuis un grand nombre d’années en Allemagne, il n’avait appris qu’à jurer en allemand et cela en italianisant impitoyablement ses jurons.
– Ferroflucto spitcheboubio ! (maudite canaille), disait-il de presque tous les Allemands.
En revanche, il parlait l’italien en perfection, car il était originaire de Sinigaglia, où l’on peut entendre la lingua toscana in bocca romana.
Emilio faisait le paresseux et s’abandonnait aux agréables sensations d’un convalescent qui vient d’échapper à un grand danger. Du reste il était facile de voir qu’il avait l’habitude d’être gâté tant et plus par tous les siens.
Il remercia Sanine, d’un air confus, mais son attention se concentrait sur les sirops ou les bonbons.
Sanine fut obligé de prendre deux grandes tasses d’excellent chocolat et d’absorber une quantité fabuleuse de biscuits ; à peine venait-il d’en grignoter un, que déjà Gemma lui en offrait un autre, – et comment aurait-il pu refuser ?
Au bout de quelques instants Sanine se sentit dans cette famille comme chez lui ; le temps s’envolait avec une rapidité incroyable.
Sanine parla beaucoup de la Russie, de son climat, de la société russe, du moujik, et surtout des cosaques, de la guerre de 1812, de Pierre-le-Grand, des chansons et des cloches russes.
Les deux femmes avaient une notion très vague du pays où Sanine était né, et Sanine fut stupéfait, lorsque madame Roselli, ou, comme on l’appelait plus souvent, Frau Lénore, lui posa cette question :
– Le palais de glace qui avait été élevé à Saint-Pétersbourg au siècle dernier, et dont j’ai lu dernièrement la description dans un livre intitulé : Bellezze delle arti, existe-t-il encore ?
– Mais croyez-vous donc qu’il n’y a jamais d’été en Russie ? s’écria Sanine.
Et alors madame Roselli avoua qu’elle se représentait la Russie comme une plaine toujours couverte de neiges éternelles, et habitée par des hommes vêtus toute l’année de fourrures et qui sont tous militaires : – il est vrai, ajouta-t-elle, que c’est le pays le plus hospitalier de la terre, et le seul où les paysans sont obéissants.
Sanine s’efforça de lui donner, ainsi qu’à sa fille, des notions plus exactes sur la Russie. Lorsqu’il en vint à parler de musique, madame Roselli et sa fille le prièrent de leur chanter un air russe, et lui montrèrent un minuscule piano, dont les touches en relief étaient blanches et les touches plates noires. Sanine obéit sans faire de façons, et s’accompagnant de deux doigts de la main droite et de trois doigts de la main gauche (le pouce, le doigt du milieu et le petit doigt), il se mit à chanter, d’une voix de ténor un peu nasale, le Saraphan, puis Sur la rue, sur le pavé.
Ses auditrices louèrent fort sa voix et sa musique, mais s’extasièrent surtout sur la douceur et la sonorité de la langue russe, et le prièrent de leur traduire les paroles. Comme ces deux chansons ne pouvaient donner une très haute idée de la poésie russe, Sanine préféra déclamer la romance de Pouchkine : Je me rappelle un instant divin, qu’il traduisit et chanta. La musique était de Glinka.
L’enthousiasme de madame Roselli et de sa fille ne connut plus de bornes. Frau Lénore découvrit une ressemblance étonnante entre le russe et l’italien. Elle trouva même que les noms de Pouchkine (elle prononçait Poussekine) et de Glinka sonnaient comme de l’italien.
Sanine à son tour obligea la mère et la fille à lui chanter quelque chose : elles ne se firent pas prier. Frau Lénore se mit au piano et chanta avec Gemma quelques duettini et stornelli. La mère avait dû avoir dans le temps un bon contralto ; la voix de la jeune fille était un peu faible, mais agréable.
C’était Gemma et non sa voix que Sanine admirait.
Il était assis un peu en arrière et de côté, et pensait qu’un palmier ne pourrait pas rivaliser avec l’élégante sveltesse de la taille de la jeune Italienne, et lorsqu’elle levait les yeux dans les passages expressifs, il semblait au jeune homme que devant ce regard le ciel devait s’ouvrir.
Le vieux Pantaleone lui-même, qui écoutait gravement, d’un air de connaisseur, une épaule appuyée au battant de la porte, le menton et la bouche enfouis dans son ample cravate, subissait le charme de ce beau visage, bien qu’il le vît tous les jours.
Ivan Sergueïevitch Tourgueniev: Eaux printanières
